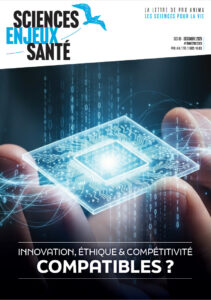PRIX DVES 2025 : Lauréat Développement & Applicabilité
PDAC-ON-A-CHIP, UNIVERSITÉ DE LORRAINE
SES116 – Mars 2025Prof Halima Alem-Marchand est docteure en Science des Matériaux de l’Université catholique de Louvain en Belgique. Son activité de recherche se concentre sur des approches interdisciplinaires visant à intégrer la bio-impression et les organes sur puce pour la modélisation des cancers ; travaux qu’elle mène notamment avec l’Institut de Cancérologie de Lorraine.
Dr Lina Bezdetnaya-Bolotine est docteur en biophysique de l’université médicale d’État de Moscou, en Russie. En 1993, elle rejoint l’université Henri Poincaré de Nancy puis est nommée professeure. Depuis 2005, elle fait partie du Centre de Recherche en Automatique (CRAN), CNRS, Nancy-Université où elle développe des modèles 3D pour reproduire le microenvironnement tumoral dans le but de proposer une approche par thérapie anti-cancéreuse personnalisée.

Comité Pro Anima : Pourriez-vous présenter en quelques mots, pour nos lecteur(rice)s, votre projet “PDAC on a chip”, ses particularités, les objectifs et résultats (en matière d’innovation et/ou d’application) que vous attendez et sous quelles échéances ?
Prof Halima Alem-Marchand & Dr Lina Bezdetnaya : Notre projet vise à remplacer les modèles animaux dans la recherche sur le cancer en développant un modèle de PDAC (adénocarcinome canalaire pancréatique) sur puce.
Ce modèle dynamique en plein essor va combiner deux innovations majeures :
i) La bio impression 3D composée de cellules cancéreuses vivantes, organisées dans une matrice extra cellulaire (structure en dehors des cellules) utilisant des biomatériaux qui imitent le microenvironnement tumoral. Ce modèle innovant a pour but de se rapprocher un maximum des fonctions biologiques du tissu pancréatique.
ii) Cette dernière sera placée dans des puces microfluidiques pour simuler la circulation du médicament dans le sang.
In fine, ce projet vise à la création d’une plateforme avancée « cancer-sur-puce », offrant des outils prédictifs et alternatifs à l’expérimentation animale pour avancer dans la compréhension des phénomènes de résistance aux médicaments. Ce projet a pour but ultime d’aider les chercheur(e)s à appréhender la réponse aux médicaments, leur efficacité et limites. Cette recherche permettra une analyse coûts-bénéfices optimisée tout en renforçant le respect de l’éthique animale.

P.A : La singularité du Prix Descroix-Vernier EthicScience est de promouvoir et de récompenser des programmes de recherche innovants hors modèle animal. Quelles ont été vos motivations, les raisons qui vous ont poussé à travailler et/ou à développer ces outils innovants centrés sur l’humain ?
HM et LB : Il y a un peu moins de 10 ans, nous nous sommes rencontrées et avons commencé à collaborer sur le développement de nanoparticules intelligentes pour des applications en thérapie anticancéreuse. Ensemble, nous avons démontré leur efficacité sur des cellules cultivées en 2D. Cependant, il est bien connu que ce modèle présente des limitations en termes de pertinence biologique. Nous avons donc cherché à tester les approches sur des modèles plus avancés. Avec l’émergence des organes-sur-puce, leur potentiel en recherche biomédicale et leur capacité à mieux reproduire les phénomènes biologiques humains que les modèles animaux, il nous est apparu essentiel de nous engager dans cette voie.
Le développement de modèles de cancer sur puce nous permet non seulement d’étudier en profondeur les interactions cellulaires et les mécanismes de résistance aux traitements, mais aussi de proposer une alternative éthique et plus prédictive que l’expérimentation animale. C’est pourquoi nous avons décidé de concentrer nos savoir-faire et nos efforts dans cette voie sans tests animaux à laquelle nous avons vraiment confiance.
“Ce prix reconnaît notre engagement dans une recherche éthique, innovante et tournée vers une application clinique.
Il renforce notre visibilité et nous aide à convaincre d’autres chercheur(e)s et institutions de l’importance des modèles alternatifs à l’expérimentation animale.”
P.A : Qu’est-ce qui fait selon vous la force de ces nouveaux modèles non animaux, et d’après votre expérience qu’est-ce qui motive un(e) chercheur(e) à utiliser ces outils innovants ?
HM et LB : Tout d’abord, c’est la meilleure représentativité de la physiologie humaine. Les modèles 3D associés à la microfluidique reproduisent fidèlement le microenvironnement tumoral, incluant les interactions cellulaires et la dynamique des fluides. Nos modèles permettent donc de tester les médicament/thérapies anti-cancéreuses directement sur des structures imitant les tissus humains, améliorant ainsi la reproductibilité et la prédictibilité des résultats. Aujourd’hui, plus de 90 % des molécules testées sur les cellules en 2D ou sur animaux échouent lors des essais cliniques. Avec la plateforme proposée, nous espérons obtenir une réduction significative des échecs en recherche clinique et une meilleure représentativité du PDAC et aussi offrir une chimiothèque fiable et moins coûteuse aux médecins et aux entreprises pharmaceutiques.
Un(e) chercheur(e) adopterait ces outils pour avoir un accès à des données plus pertinentes pour l’étude du cancer (mécanismes de résistance ou l’initiation du processus métastatique) et de l’efficacité ou des limites des traitements. La reproductibilité des résultats par rapport aux modèles animaux, souvent complexes et variables, est aussi un défi majeur ; ce qui pourra être limité avec ces nouveaux outils.
P.A : Dans quel contexte de la recherche (française, européenne, internationale), vos travaux s’inscrivent-ils ? Quels sont les enjeux de votre projet ?
HM et LB : Nos recherches s’inscrivent dans un contexte international où la nécessité de remplacer l’expérimentation animale devient une priorité. La Commission européenne encourage activement la recherche de modèles alternatifs aux tests sur les animaux, avec des financements dédiés (Horizon Europe). De plus, l’Agence européenne des médicaments (EMA) promeut des approches sans animaux pour les essais précliniques. Au niveau international (FDA aux États-Unis, CFDA en Chine), l’intérêt des modèles in vitro avancés se traduit par le développement de biobanques et d’organoïdes, ce qui permettra d’améliorer les outils de dépistage et de test de nouveaux traitements, notamment pour des cancers agressifs comme le PDAC.


P.A : À quel stade de votre carrière et de vos recherches ce Prix intervient-il et que vous permettra-t-il d’accomplir ?
HM et LB : Ce Prix intervient à un moment clé de notre projet, où nous avons déjà optimisé et caractérisé deux modèles de cancer (Pancréas et Ovaire) de PDAC bio imprimé simple. Avec des collègues spécialistes de dynamique des fluides, nous avons développé un système microfluidique qui a été breveté afin de pouvoir étudier plusieurs doses différentes de médicaments ainsi extraire l’information sur l’influence de la concentration sur la pénétration des médicaments dans un site cancéreux. Ce prix viendra donc soutenir un travail de thèse qui permettra d’aller plus loin dans la création d’un nouveau savoir autour de la limitation des traitements actuels.
Ce prix reconnaît notre engagement dans une recherche éthique, innovante et tournée vers une application clinique. Il renforce notre visibilité et nous aide à convaincre d’autres chercheur(e)s et institutions de l’importance des modèles alternatifs à l’expérimentation animale. À terme, notre ambition est de faire de ces modèles une nouvelle plateforme en recherche préclinique, afin de réduire progressivement la dépendance aux modèles animaux et d’offrir des solutions plus rapides et plus efficaces pour les patients.

Crédit image : Comité scientifique Pro Anima, Axel Coquemon