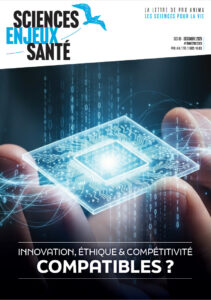Actus des méthodes non-animales
17 - 21 NOVEMBRE 2025
NEWS, RAPPORTS, PRISES DE POSITION
1. Livre blanc 2025 pour structurer le secteur français des O&OOC
La Filière française des organoïdes et des organes sur puce (F3OCI), copiloté par BioValley France et NETRI pour France Biotech, en collaboration avec le CNRS, le CEA, CEVA SANTE ANIMALE, ICARE, et l’Inserm, a publié son Livre blanc 2025 : une feuille de route ambitieuse pour structurer ce secteur français stratégique au service de la santé humaine, animale et environnementale.
Ce document clé définit 9 priorités stratégiques pour faire de la France un leader européen et mondial des méthodes alternatives et offre un panorama complet des 133 projets français recensés ainsi que des acteurs publics et privés impliqués dans la recherche, le développement et la production d’organoïdes et d’organes-sur-puce. Ce document est une invitation à l’action. Il marque une étape décisive pour transformer
un potentiel immense en bénéfices concrets pour la santé humaine, animale et
environnementale.
2. Orientation de l’OCDE sur la production, la communication et l’utilisation des données de recherche pour les évaluations réglementaires
Le document porte sur les données d’évaluation des dangers, de l’exposition et des risques produites en dehors des cadres d’essais réglementaires formels. Il encourage des approches harmonisées et structurées afin de favoriser l’utilisation d’informations scientifiquement robustes, fiables et pertinentes pour la prise de décision, et ce, dans tous les contextes juridiques et politiques.
Ce document d’orientation comprend des considérations pratiques et des recommandations spécifiques à l’intention des principaux acteurs concernés, notamment les financeurs, les chercheur(e)s, les éditeurs, les gestionnaires d’archives, les évaluateurs et les gestionnaires de risques. D’autres sections proposent des outils, des références et des études de cas pour aider les acteurs concernés à mettre en œuvre ces orientations.
Consulter le document d’orientation de l’OCDE (EN)
3. EU Biotech Act : L’appel de EFPIA et Vaccines Europe
Face au déclin de l’Europe dans les investissements pharmaceutiques mondiaux et les essais cliniques, et à la progression rapide d’autres régions, il est urgent d’agir pour maintenir l’innovation et la R&D à forte valeur ajoutée en Europe. Le règlement sur les biotechnologies (EU Biotech Act) peut inverser cette tendance et faire de l’UE la région la plus dynamique, prévisible et favorable à l’innovation en biotechnologies.
L’EFPIA et Vaccines Europe (VE) exhortent ainsi à une action coordonnée pour renforcer la compétitivité de l’Europe, consolider son écosystème biotechnologique et attirer les investissements des plus grands innovateurs pharmaceutiques mondiaux. Nathalie Moll, directrice générale de l’EFPIA, a déclaré : « L’innovation repose sur un écosystème fondé sur l’excellence scientifique, une réglementation prévisible et des conditions d’investissement compétitives. Le Biotech Act offre à l’Europe une occasion unique de reprendre le leadership dans les sciences de la vie, de revitaliser son écosystème d’innovation et de garantir que les générations futures de patient(e)s bénéficient des découvertes et des technologies développées ici. »
En savoir plus (EN)
4. European Innovation Act : Position de l’ESFRI
Le document présente le positionnement de l’European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) sur les aspects clés de la loi européenne sur l’innovation (European Innovation Act – EIA), en veillant à ce que les opportunités offertes par les infrastructures de recherche et de technologie (IR) pour la compétitivité européenne et le développement technologique soient pleinement prises en compte dans l’EIA.
Le rapport formule plusieurs recommandations, telles que la promotion des transferts de technologie, des initiatives de codéveloppement et de collaborations plus étroites avec l’industrie et les PME. Par ailleurs, le rapport sur la coopération des IR de l’ESFRI avec l’industrie, basé sur des enquêtes menées auprès de cette dernière, a identifié le manque de ressources financières, le manque de personnel au sein des entreprises et les problèmes juridiques (par exemple, la propriété intellectuelle) comme les principaux obstacles à la coopération avec les IR.
En savoir plus (EN)
5. IHI VICT3R : Réduire l’utilisation d’animaux avec la mise en place de groupes témoins virtuels
Malgré les progrès rapides réalisés dans les technologies d’analyse pertinentes pour l’humain et d’autres approches innovantes in vitro et in silico, l’évaluation de la sécurité des produits chimiques et des médicaments continue de reposer largement sur l’expérimentation animale, en partie en raison de la lenteur de l’adaptation réglementaire et de l’absence de stratégies de transition.
Un nouvel article souligne la nécessité de mettre en place des initiatives pragmatiques de transition qui réduisent l’utilisation d’animaux tout en préservant la rigueur scientifique et la confiance réglementaire, en mettant l’accent sur l’Innovative Health Initiative projet VICT3R. Le projet VICT3R se concentre sur le perfectionnement et la mise en œuvre de la méthodologie VCG (Virtual Control Groups), en particulier dans la normalisation, la conservation et l’appariement adéquat des données de contrôle historiques, ainsi que dans la qualification réglementaire.
Lire l’article (EN)
INTERVIEWS, NOMINATIONS, RÉCOMPENSES
6. Le chemin vers la création d’un laboratoire de recherche centré sur l’humain
Une nouvelle ère s’ouvre pour la recherche biomédicale ; la communauté scientifique se tournant de plus en plus vers la recherche spécifiquement humaine. Au cœur de cette transformation se trouvent les individus et les groupes qui s’emploient activement à développer et à adopter des approches plus efficaces et éthiques. Afin de mieux comprendre les enjeux de cette transition, le Centre for Human Specific Research invite des experts de renom à partager leur expérience.
Dans cet article, Dr Dania Movia, professeure adjointe en sciences biomédicales et services de santé au Département de biologie de l’Université de Maynooth, partage son parcours pour fonder et diriger le Humane Biomedical Research Group – le premier laboratoire de recherche irlandais dédié à la recherche respiratoire centrée sur l’humain.
Lire l’interview (EN)
7. Inside Science sur BBC Radio 4 consacré au plan du gouvernement britannique pour des alternatives
Le gouvernement britannique a récemment présenté sa vision d’un monde où l’utilisation d’animaux en science est éliminée, sauf circonstances exceptionnelles.
Le présentateur de l’émission Inside Science de BBC Radio 4, Tom Whipple, reçoit Chris Powell, directeur de Cambridge BioPharma Consultants Ltd. et chercheur invité honoraire à l’Université de Cambridge, ainsi que Natalie Burden, responsable des nouvelles méthodologies au NC3Rs, afin de discuter de la stratégie gouvernementale en la matière et des perspectives qu’elle offre à la science britannique.
Écoutez l’épisode d’Inside Science sur BBC Radio 4 (EN)
8. Les lauréat(e)s du programme NC3Rs obtiennent un financement dans le cadre de l’appel à projets du MRC
Le NC3Rs s’est récemment associé au UKRI MRC (Medical Research Council), Wellcome and Innovate UK pour un appel à projets visant à développer des modèles humains in vitro de maladies complexes. Bien que l’appel ait principalement porté sur les bénéfices pour la santé humaine, l’expertise du NC3Rs a permis de prendre en compte le potentiel de ces travaux en matière de remplacement des animaux lors de l’évaluation des demandes de subvention.
Cinq équipes interdisciplinaires ont obtenu un financement total de 15,9 millions de livres sterling pour des projets axés sur le développement de modèles in vitro du foie, du cerveau, des vaisseaux sanguins, du cancer et de la douleur. Parmi ces équipes figurent d’anciens lauréats du programme NC3Rs. L’un des projets, dirigé par Amir Ghaemmaghami et Nick Hannan de l’Université de Nottingham, s’appuie sur une plateforme développée grâce à un financement du programme NC3Rs.
En savoir plus (EN)
OUTILS, PLATEFORMES, APPELS
9. Appel aux jeunes chercheur(e)s travaillant dans le domaine des NAM
Le programme de formation du Johns Hopkins Center for Alternatives to Animal Testing (CAAT), en partenariat avec l’Université d’Utrecht, l’Université Radboud et le Safer Medicines Trust, a lancé un sondage de 15 à 20 minutes dédié aux jeunes chercheur(e)s afin de mieux comprendre les expériences et les difficultés qu’ils et elles rencontrent.
Les réponses aideront à identifier les obstacles réels, à développer des formations et un mentorat adaptés, à renforcer les politiques publiques, ainsi qu’à créer de nouvelles opportunités pour soutenir les jeunes chercheur(e)s qui font progresser une science éthique et innovante.
Répondre à l’enquête (EN)
Pro Anima a intégré une liste actualisée des appels sur son interface NAMs
Découvrez notre interface d’appels
INDUSTRIES, BIOTECHS, PARTENARIATS
10. Premier modèle d’IA basé sur le séquençage traduisant les variations génétiques individuelles en profils d’activité tissulaire à grande échelle
Développé par les chercheurs de Biohub, VariantFormer est le premier modèle d’IA basé sur le séquençage capable de traduire directement les variations génétiques individuelles en profils d’activité tissulaire à grande échelle. VariantFormer capture également, de manière implicite, l’influence génétique de l’épigénome sur l’expression des gènes. VariantFormer utilise une approche intégrée pour prédire les profils d’expression génique directement à partir de la séquence d’ADN d’une personne. Cette approche offre une nouvelle méthode puissante pour explorer comment le patrimoine génétique unique d’un individu influence sa santé.
VariantFormer représente une étape importante dans la réalisation du défi de Biohub : “Building an AI-based virtual cell model”. Il fournit une nouvelle plateforme qui capture les interactions génétiques complexes qui régissent le comportement des cellules. À plus grande échelle, il s’agit d’une première étape dans un long cheminement vers l’utilisation de modèles prédictifs pour étudier, traiter et prévenir même les facteurs génétiques les plus difficiles à identifier à l’origine des maladies.
En savoir plus (EN)
DÉCOUVERTES SCIENTIFIQUES & PROTOCOLES
11. Etude des mutations du gène SMAD2 associées aux cardiopathies congénitales avec des iPSC humaines
Les observations cliniques de patient(e)s atteint(e)s de cardiopathies congénitales et porteur(se)s de variants génétiques du gène SMAD2 ont révélé des corrélations avec des atteintes multiorganiques aux niveaux développemental et fonctionnel. De nombreux(ses) patient(e)s présentent une glomérulosclérose, une fibrose périglomérulaire et une albuminurie. Toutefois, on ignore encore largement si les variants du gène SMAD2 associés aux cardiopathies congénitales peuvent altérer directement le devenir des cellules rénales, l’organisation tissulaire et la fonction rénale.
Une étude récente a exploré le rôle des variants pathogènes du gène SMAD2 dans la podocytogenèse, la spécification de la lignée cellulaire néphrogénique et la fonction de la barrière de filtration glomérulaire, en combinant la modélisation de la maladie par une approche CRISPR avec des cellules souches humaines (iPSC) et les technologies microfluidiques d’OOC. Cette étude suggère un lien entre les mutations du gène SMAD2 associées aux cardiopathies chroniques et les malformations du tissu rénal, ce qui pourrait éclairer le développement de thérapies régénératives ciblées.
Consultez l’étude dans Nature Biomedical Engineering (EN)
12. miBrain : Première plateforme cérébrale 3D humaine intégrant six types cellulaires majeurs dans une culture unique
Pour pallier le manque de modèles cellulaires humains intégrant les six principaux types cellulaires cérébraux – pourtant essentiels pour reproduire les caractéristiques de la physiopathologie cérébrale et accélérer la compréhension des mécanismes et les essais thérapeutiques -, des chercheur(e)s ont développé, caractérisé et exploité un modèle cérébral préclinique spécifique aux patients. Ce modèle est composé de neurones, de microglie, d’oligodendrocytes, d’astrocytes, de péricytes et de cellules endothéliales microvasculaires cérébrales dérivés de cellules souches pluripotentes induites (iPSC).
Ce système multicellulaire intégré (miBrain) reproduit des caractéristiques similaires à celles observées in vivo, notamment l’activité neuronale, la connectivité fonctionnelle, la fonction de barrière, l’interaction des oligodendrocytes producteurs de myéline avec les neurones, les interactions multicellulaires et les profils transcriptomiques. Les chercheur(e)s ont également utilisé ce modèle pour étudier les pathologies de la maladie d’Alzheimer associées au risque génétique APOE4. « Sa conception hautement modulaire distingue miBrain, offrant un contrôle précis des entrées cellulaires, des contextes génétiques et des capteurs, des atouts précieux pour les applications telles que la modélisation des maladies et les essais de médicaments », a déclaré Alice Stanton, co-auteure de l’étude.
Lire l’article dans PNAS (EN)