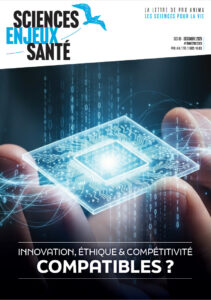Prof. Carole Mathelin & Dr Meriem Koual
Santé, Cancer & Environnement : Vers une évaluation des risques plus intégrée, dynamique et prédictive
SES117 – Juin 2025Malgré les progrès médicaux, les cancers demeurent la première cause de mortalité en France. Le 9 avril dernier, l’Académie nationale de chirurgie organisait son point presse sur le sujet « Environnement et cancers : état des connaissances et enjeux de la recherche » avec les interventions du Professeur Carole Mathelin, Présidente de l’Académie de chirurgie, et du Dr Meriem Koual, médecin-chercheuse au sein de l’unité INSERM HealthFex. Dans cette interview, nous donnons la parole à ces deux grandes spécialistes qui ont bien voulu partager leurs expertises sur ces enjeux essentiels.
Comité scientifique Pro Anima : Comment et pourquoi en êtes-vous arrivées à vous intéresser au lien santé-environnement et quels risques / classe de molécules vous intéressent particulièrement dans le cadre de votre travail ?
Pr Carole Mathelin : Les équipes spécialisées dans la prise en charge des cancers du sein et l’Académie Nationale de Chirurgie (ANC) s’intéressent particulièrement aux liens cancer du sein-environnement, car l’incidence du cancer du sein est très élevée en France, proche de celle des Etats-Unis, du Canada, de certains pays européens et de l’Australie. Les taux d’incidence y sont proches ou légèrement supérieurs à 100/100 000 habitants. Même s’il peut y avoir des disparités dans le recueil des données de ces différents pays, le constat est inquiétant dans tous ces pays, car environ 10 à 11% des femmes seront touchées par cette maladie avant leurs 75 ans.
En France, le cancer du sein représente la première cause de mortalité par cancer chez la femme. Chaque année plus de 62 000 femmes sont concernées par cette maladie et environ 12 000 en décèdent. Dans 25% de ces cas, l’origine du cancer trouve une explication dans la présence de facteurs de risque connus (dont des facteurs génétiques). Pour les 75% de cas restants, aucun de ces facteurs de risque n’est identifié.
Sans actions collectives sur la réduction des facteurs de risque connus, l’identification de nouveaux facteurs, l’amélioration du diagnostic précoce et de la prise en charge thérapeutique des cancers du sein, l’International Agency for Research on Cancer (IARC) a calculé une augmentation significative du nombre de cas et de la mortalité en France (estimée à environ 20 000 décès annuels dans les deux prochaines décennies).
Tout cela explique l’implication forte de l’ANC dont la plupart des membres sont confrontés à la chirurgie des cancers au sein des 13 spécialités chirurgicales, et les avancées dans une spécialité chirurgicale peuvent être utiles à d’autres spécialités. A titre d’exemple, les cancers du sein, du pancréas ou de la prostate ont des liens démontrés avec les hormones et donc les perturbateurs endocriniens de l’environnement, et les progrès réalisés dans une spécialité seront partagés avec les autres disciplines.
En France, le cancer du sein représente la première cause de mortalité par cancer chez la femme. Dans 25% de ces cas, l’origine du cancer trouve une explication dans la présence de facteurs de risque connus (dont des facteurs génétiques). Pour les 75% de cas restants, aucun de ces facteurs de risque n’est identifié
Pr Carole Mathelin
Dr Meriem Koual : J’ai découvert la toxicologie et la santé environnementale dans le cadre de mon master 2 recherche en 2014, réalisée dans l’unité INSERM UMR‑S 1124 rattaché à l’Université Paris Cité qui s’intéresse à l’étude des effets des expositions environnementales, en particulier des polluants chimiques dont les pesticides et les perturbateurs endocriniens sur la santé humaine.
Les recherches développées par le laboratoire visent à comprendre les effets de divers composés, seuls ou mélange, au niveau cellulaires et moléculaires (régulation des gènes et des voies de signalisation cellulaire, stress oxydatif, l’inflammation …) et leur impact dans les maladies chroniques comme les troubles métaboliques, les maladies neurodégénératives et les cancers. Nous cherchons également à identifier des biomarqueurs et d’outils diagnostiques permettant de mieux évaluer les effets des expositions environnementales, et étudions des stratégies innovantes pour prévenir ou traiter les effets délétères des expositions environnementales par l’identification de cibles thérapeutiques.
Depuis 10 ans, mes travaux dans le cancer du sein s’intéressent particulièrement aux effets des polluants organiques persistants qui présentent des caractéristiques physico-chimiques particulières et qui, même s’ils sont interdits depuis de très nombreuses années pour certains, sont encore très présents dans notre environnement. Je travaille depuis cette année sur l’endométriose et plusieurs pesticides dont la chlordécone mais aussi les perturbateurs non persistants tels que les phtalates ou les parabènes seront étudiés (Projet ANR ENDOFAT).

Comité Pro Anima : Parmi les perturbateurs endocriniens (PE), hormis ceux classés 1 ou 2a par le CIRC (Centre international de Recherche sur le Cancer), quels sont ceux qui ont une forte probabilité d’être des promoteurs tumoraux et nécessiteraient une vigilance particulière en matière de politique publique ?
Dr Koual : Parmi les PE préoccupants figurent le bisphénol A, les phtalates (DEHP, DBP, BBP), les parabènes, certains pesticides émergents comme les néonicotinoïdes, les composés perfluorés (PFOA, PFOS), les retardateurs de flamme bromés (PBDE), ainsi que certains métaux comme le cadmium. Ces composés pour lesquels les études publiées se multiplient sont capables d’induire un stress oxydatif, de modifier l’expression génique liée à la cancérogenèse ou à la progression tumorale. Les études expérimentales ont montré qu’ils étaient capables d’augmenter la prolifération cellulaire, la migration cellulaire, l’invasion, la néoangiogénèse ou encore la résistance à l’apoptose dans divers modèles expérimentaux. Une exposition fréquente, chronique et multiples à ces composés de la population justifie des mesures réglementaires renforcées et une surveillance continue.
Comité Pro Anima : Dans notre compréhension de la complexité des expositions et leurs conséquences physio-pathologiques, est-ce que vous attendez beaucoup de la notion d’exposome ? En quoi les nouvelles approches et stratégies (IA, stratégie analytique, techniques omiques) contribuent-elles à enrichir les données sur l’exposome ?
Pr Mathelin : En 2005, le Dr Christopher Wild a défini l’exposome comme « la totalité des expositions auxquelles un individu est soumis de la conception à la mort. C’est une représentation complexe et dynamique des expositions auxquelles une personne est sujette tout au long de sa vie, intégrant l’environnement chimique, microbiologique, physique, récréatif, médicamenteux, le style de vie, l’alimentation, ainsi que les infections ».
Le cancer du sein est un excellent exemple du rôle de l’exposome sur sa survenue, sa croissance, sa sensibilité aux différentes thérapeutiques et son pronostic. Il a en effet été démontré sur ces différents paramètres, l’importance des expositions hormonales (ménarche précoce, ménopause tardive, nulliparité, grossesses tardives, certains traitements hormonaux…), du mode de vie (l’obésité après la ménopause, la consommation d’alcool, la sédentarité, la carence en soleil ou bien encore en sommeil qui en accroissent les risques…), de l’exposition à la lumière nocturne, de certaines maladies (diabète de type 2, hyperthyroïdie, hémochromatose, maladie de Hodgkin…), mais aussi l’environnement chimique (perturbateurs endocriniens, PFAS, métaux…).
L’exposome étant immensément complexe et ayant un impact tout au long de la vie, en débutant dès la conception, voire avant, des nouvelles stratégies utilisant l’intelligence artificielle (comme la plateforme numérique appelée Onconum qui utilise une méthode hybride s’appuyant sur des approches d’apprentissage automatique)1 et des techniques omiques2, vont incontestablement enrichir sa compréhension.
L’exposome étant immensément complexe et ayant un impact tout au long de la vie, en débutant dès la conception, voire avant, des nouvelles stratégies utilisant l’intelligence artificielle et des techniques omiques, vont incontestablement enrichir sa compréhension.
Pr Carole Mathelin
Dr Koual : L’exposome est un concept développé comme un complément au génome, il représente un déterminant majeur de la santé et du bien-être, tant individuel que collectif. Certaines de ces expositions étant évitables, une meilleure compréhension de l’exposome ouvre des perspectives essentielles en matière de prévention. Plusieurs initiatives, notamment autour de l’exposome chimique, ont permis de clarifier et d’opérationnaliser ce concept. Dans cette dynamique, l’Académie nationale de médecine a formulé des recommandations pour renforcer la prise en compte des effets de l’exposome sur la santé. Ces recommandations visent à intégrer la notion d’exposome dans la vie quotidienne.
Les progrès technologiques actuels permettent une caractérisation plus étendue et précise de l’exposome chimique, aussi bien dans les matrices humaines qu’environnementales. Cette avancée repose sur l’amélioration des outils de mesure des expositions et sur une prise en compte plus fine des effets liés aux mélanges complexes de polluants chimiques. Ces avancées permettent également une meilleure compréhension des effets cellulaires et moléculaires sous-jacents grâce aux techniques omiques (protéomique, RNA seq…). Les données épidémiologiques disponibles sont souvent incomplètes et coûteuses à obtenir.
L’IA offre des perspectives intéressantes. L’analyse de grands jeux de données permettra par exemple une meilleure caractérisation des expositions et de leurs impacts et la modélisation dans le champ de la toxicologie. On peut citer par exemple les analyses des bases de données ouvertes environnementales existantes ou des images satellitaires haute résolution de grandes villes qui peuvent être couplées à des registres de pathologies pour explorer divers risques.

Comité Pro Anima : Y a t‑il des exemples concrets de progrès réalisés grâce aux NAM en matière de prévention, de caractérisation, de mécanismes d’action ou bien en matière de traitement ? Selon vous, où se situent la France et l’Europe dans le domaine ?
Dr Koual : Les nouvelles approches méthodologiques ou NAM ont permis des avancées concrètes dans plusieurs domaines clés liés à la santé environnementale. Ces approches, qui reposent sur des outils innovants tels que la toxicogénomique, les organoïdes, les tests in vitro à haut débit ou encore les modélisations in silico (via des analyses bioinformatiques), permettent d’identifier plus précocement les effets toxiques de certaines substances et d’en prédire la dangerosité sans recourir systématiquement à l’expérimentation animale. En matière de prévention, les NAM facilitent une meilleure évaluation des risques, notamment via la bio-surveillance à haut débit ou l’analyse fine de l’exposome. Sur le plan mécanistique, elles permettent de modéliser les voies de signalisation et les effets délétères via les schémas AOP (Adverse Outcome Pathways), ce qui éclaire les relations entre expositions et effets pathologiques. Dans le domaine thérapeutique, les modèles dérivés de cellules humaines, comme les organoïdes, offrent des perspectives intéressantes pour tester des substances en conditions proches de la réalité physiologique et adapter les traitements à la réponse spécifique de l’individu.
Sur le plan international, l’Europe figure parmi les leaders dans le développement et l’intégration des NAM, notamment à travers ses politiques ambitieuses en matière de santé environnementale (comme REACH, Horizon Europe, ou les travaux de l’ECHA et de l’EFSA). La France s’inscrit activement dans cette dynamique, avec la mobilisation d’acteurs comme l’Anses, l’Inserm ou le CNRS. Toutefois, des obstacles subsistent, notamment en ce qui concerne la validation scientifique et réglementaire de ces méthodes, qui doivent encore gagner en reconnaissance pour remplacer les approches classiques. Malgré cela, les NAM s’imposent de plus en plus comme des outils indispensables pour faire évoluer les pratiques vers une évaluation plus éthique, rapide et prédictive des risques sanitaires et environnementaux.
Comité Pro Anima : La Commission européenne est en train d’établir une feuille de route pour une sortie progressive des tests sur animaux pour l’évaluation des risques chimiques. Comment les médecins / chirurgiens impliqués dans le lien environnement-santé pourraient contribuer à ce projet conséquent ?
Pr Mathelin : Outre les problématiques éthiques, les études chez l’animal sont très éloignées de l’humain, lorsqu’elles concernent l’impact de l’exposome ou de l’environnement sur la santé. Les répercussions de la vie sociale, de l’activité professionnelle, des prises médicamenteuses, des voyages, du stress …tout au long de la vie (sur une espérance de vie de plus 80 ans) ne peuvent évidemment pas être analysées sur l’animal. La plupart des médecins / chirurgiens sont très en faveur de la sortie progressive des tests sur animaux dans ce contexte.
A titre d’exemple, une recherche que soutient l’ANC vise à étudier les corrélations entre perturbateurs endocriniens et cancer du sein dans une cohorte de 3600 échantillons tumoraux et/ou péritumoraux provenant de patientes opérées pour un cancer du sein ou pour une pathologie mammaire bénigne ou une stratégie chirurgicale de réduction de risque. Les patientes sont incluses dans la cohorte nommée Senometry (NTC02810093). Les participantes à cette étude signent un consentement éclairé qui autorise les chirurgiens à utiliser une toute petite partie de leurs tissus mammaires à des fins de recherche. Pour toutes ces femmes, des échantillons de tumeurs cancéreuses ou non cancéreuses et de leurs tissus péritumoraux sont adressés à des laboratoires experts pour dosage d’un large panel de perturbateurs endocriniens (pesticides, PFAS et métaux) pour mieux comprendre les liens environnement/santé du sein. La place des chirurgiens est donc essentielle.
Dr Koual : Les médecins et chirurgiens engagés dans le domaine environnement-santé peuvent jouer un rôle déterminant dans la transition vers une évaluation des risques. Notre expertise clinique peut permettre d’orienter les priorités de recherche en lien avec les pathologies observées. En collaborant avec les chercheur(e)s, nous pouvons permettre une meilleure intégration des données cliniques dans les questions de recherche. Nous pouvons participer à la validation des nouvelles méthodes (in vitro, in silico) en évaluant leur pertinence chez nos patient(e)s. En participant à l’intégration des données environnementales dans le dossier médical et le soin, nous pouvons aider à mieux caractériser les expositions réelles et mieux prendre en compte les susceptibilités individuelles. Nous avons également un rôle important à jouer dans la formation, la sensibilisation des patient(e)s. Notre rôle est selon moi important pour renforcer la dimension humaine, préventive et personnalisée de l’analyse des risques chimiques.
Les médecins et chirurgiens engagés dans le domaine environnement-santé peuvent jouer un rôle déterminant dans la transition vers une évaluation des risques. Notre expertise clinique peut permettre d’orienter les priorités de recherche en lien avec les pathologies observées.
Dr Meriem Koual
Comité Pro Anima : Les populations sensibles (femmes enceintes, nourrissons, enfants, personnes âgées, diabétiques, etc) ne sont pas toujours suffisamment prises en compte dans les études précliniques et cliniques. En quoi les NAM pourraient-elles combler ce manque ? Quel rôle l’approche de la médecine de précision peut jouer dans ces évaluations de risque ?
Dr Koual : Les NAM pourraient offrir des outils innovants pour mieux prendre en compte les populations sensibles, souvent négligées dans les études classiques. En utilisant des modèles humains adaptés (cellules, organoïdes, données omiques), elles permettraient d’évaluer les effets spécifiques selon l’âge, le sexe ou certaines pathologies. Les simulations in silico pourraient intégrer des profils physiologiques variés, comme ceux des femmes enceintes ou des personnes âgées. Ces approches révéleraient les différences de vulnérabilité face aux substances chimiques. Couplées à la médecine de précision, elles permettraient d’identifier les sous-groupes à risque et d’adapter les évaluations et les mesures de prévention. Cette stratégie renforcerait la pertinence des évaluations pour la santé publique. Elle contribuerait à une prévention plus ciblée, personnalisée et équitable. Ainsi, les NAM et la médecine de précision rendraient l’évaluation des risques plus réaliste, inclusive et tournée vers les besoins réels des populations.
Comité Pro Anima : L’Académie nationale de Chirurgie semble avoir une volonté forte de communication auprès de différents publics. Quels enjeux l’Académie souhaite-t-elle mettre en avant, notamment en matière d’information et de prévention des patient(e)s et de la société civile ? Comment imaginez-vous cette mise en œuvre ?
Pr Mathelin : C’est avec enthousiasme que l’ANC communique régulièrement (auprès de la communauté mondiale des chirurgiens tous les mercredis après-midi, auprès du grand public lors de rencontres sur le terrain, auprès des décideurs politiques…), pour accompagner, valoriser et diffuser l’excellence de la chirurgie française et de ses progrès. L’ANC accompagne les profonds changements des parcours chirurgicaux des patients (avec le développement de la chirurgie ambulatoire, robot-assistée, guidée par la réalité virtuelle ou bien encore le recours à la chirurgie hors-bloc ou les hébergements transitoires non médicalisés) en veillant à ce que tous les talents chirurgicaux (qu’ils soient ou non académiciens) puissent s’exprimer sur leurs innovations et actualités, lors des points-presse régulièrement organisés.
Dans sa communication, l’ANC ambitionne, dans la période actuelle où le métier de chirurgien est bouleversé par les évolutions technologiques, institutionnelles et sociétales, d’anticiper et d’accompagner ces changements, en les expliquant et en tenant compte des facteurs sociaux, économiques et démographiques de notre société. Par exemple, nos ainées et ainés vont créer de nouveaux défis qui nécessiteront des solutions innovantes en communication. Notre ambition, c’est aussi par notre communication, de contribuer à réduire les inégalités d’accès aux soins, afin que les bénéfices de la chirurgie de demain soient équitablement accessibles. Enfin, la question de l’environnement nous conduira à une gestion plus efficace des ressources, une réduction des déchets et une communication sur l’intégration des pratiques éco-responsables dans nos activités et en particulier dans nos blocs opératoires.
L’ANC constitue une communauté chirurgicale solide et unie au service de la santé de toutes et tous, dont le savoir-faire doit s’accompagner d’un faire-savoir auprès de la communauté soignante et du grand public.
Comité Pro Anima : Comment imaginez-vous vos travaux de recherches et l’évaluation de risques en France et en Europe si on faisait une projection dans 10 ans ?
Pr Mathelin : Beaucoup d’arguments sont actuellement avancés en faveur d’un lien entre les perturbateurs endocriniens et la santé mais la recherche actuelle souffre de 5 écueils majeurs qui seront probablement corrigés dans les 10 années qui viennent, grâce en particulier au savoir-faire évolutif des data scientists et l’implication des professionnels de santé :
- Le plus grand nombre d’études s’intéressant à ce sujet ont été réalisées sur des modèles in vitro et chez l’animal, donc très éloignées de l’humain, concernant en particulier l’impact de l’exposome. Ce sont les études cliniques qui répondront à nos questions sur les liens santé-environnement. L’étude des perturbateurs endocriniens dans les tissus pathologiques permettra de comprendre leurs cibles tissulaires et donc leurs conséquences sur l’évolutivité de la maladie et sa curabilité.
- Il existe des études épidémiologiques sur les liens santé-environnement, mais les données sont souvent obtenues de façon rétrospective utilisant des questionnaires avec en conséquence des biais multiples, en particulier de mémorisation. Il faudra encourager l’obtention d’enregistrement prospectif et exhaustif des données, en favorisant la sécurisation de ces très grandes bases de données de santé.
- De plus, ces études portent le plus souvent sur un temps court et permettent pas d’analyser les réponses aux traitements, ni les taux de récidives ou décès faute d’un suivi suffisamment long ou des perdus de vue. Il faudra encourager l’obtention d’enregistrement prospectif et exhaustif des données, en favorisant le recueil sur le long terme.
- Il n’y a pas d’études chez l’Homme analysant un grand nombre de pesticides, de PFAS, de métaux et de manière générale les différents composants de l’exposome pour connaître notamment leurs interactions, leur effet « cocktail » ou leur effet « dose ». Les nouvelles technologies permettront ces analyses combinées multiparamétriques.
- Enfin, la plupart des études cliniques s’intéressent à l’adulte sans comorbidité, sans pathologies multiples, en excluant régulièrement les mineurs, les femmes enceintes ou allaitantes et les gens âgés. Il y a trop peu d’études cliniques permettant l’analyse des fenêtres de vulnérabilité (vie in utero, adolescence, grossesse, ménopause, grand âge) ou l’implication d’autres pathologies qu’il faudra à tout prix encourager dans le futur…
Les technologies d’avenir, passant par le recueil, la sécurisation et l’analyse des données, associées à la transdisciplinarité devraient permettre d’identifier des causes de maladies jusqu’alors inconnues, et d’apporter des preuves aux corrélations supposées entre les toxiques environnementaux et la santé, favorisant ainsi le soutien d’actions de santé publique et de prévention s’intégrant dans le cadre de la santé environnementale.
L’évaluation des risques deviendra plus intégrée, dynamique et prédictive, grâce à l’exploitation de grandes bases de données environnementales, épidémiologiques et toxicologiques, combinées à l’IA et aux modèles mécanistiques
Dr Meriem Koual
Dr Koual : Dans 10 ans, on peut imaginer que les travaux de recherche et l’évaluation des risques en France et en Europe auront profondément évolué sous l’impulsion des avancées technologiques, des politiques environnementales renforcées, et de la montée en puissance du concept d’exposome. L’évaluation des risques deviendra plus intégrée, dynamique et prédictive, grâce à l’exploitation de grandes bases de données environnementales, épidémiologiques et toxicologiques, combinées à l’intelligence artificielle et aux modèles mécanistiques (AOP, systèmes multi-échelles). Les approches in silico et in vitro seront devenues la norme dans de nombreux domaines, remplaçant largement l’expérimentation animale. Les tests développés permettront d’explorer rapidement les effets de milliers de substances, y compris les effets combinés (cocktails) et les impacts à faibles doses ou à long terme.
On peut espérer que la bio-surveillance humaine sera renforcée grâce à des capteurs portables, des analyses multi-omics (génomique, métabolomique, protéomique…) et des plateformes de suivi en temps réel des expositions, et intégrer dans le dossier médical du patient. Ces outils permettront une approche personnalisée de l’évaluation des risques, tenant compte des facteurs individuels comme l’âge, le sexe, les comorbidités, ou encore le mode de vie.
J’espère que l’évaluation des risques dans 10 ans sera non seulement plus rapide et fiable, mais aussi plus humaine, préventive et adaptée aux défis environnementaux du XXIe siècle, dans un contexte où la santé et l’environnement seront reconnus comme indissociablement liés.


Dr Meriem Koual est médecin-chercheuse, spécialisée en chirurgie oncologique gynécologique et mammaire avec une expertise particulière dans le cancer du sein.Depuis 2014, elle développe au sein de l’unité INSERM HealthFex (UMR‑S 1124, Université Paris Cité) des travaux de recherche translationnelle et fondamentale portant sur l’impact des contaminants environnementaux (polluants organiques persistants, fumée de cigarette, additifs alimentaires) sur la progression métastatique et l’agressivité du cancer du sein. Ses recherches s’appuient sur une approche multidisciplinaire combinant épidémiologie (cohorte METAPOP), modèles expérimentaux et analyses in silico.