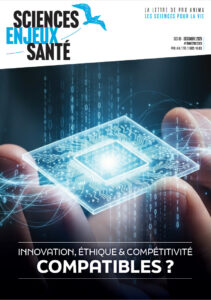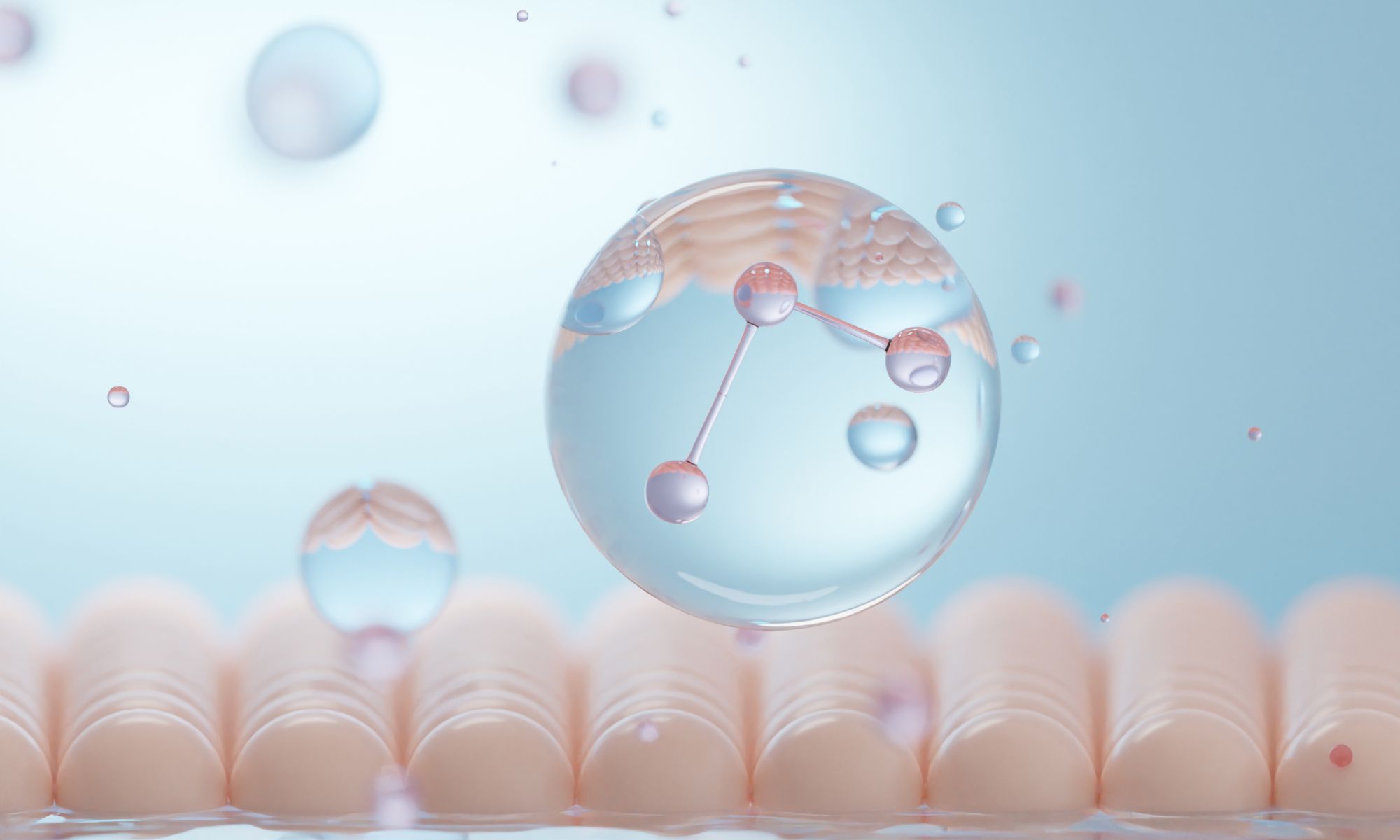
Actus des méthodes non-animales
12 - 16 MAI 2025
NEWS, RAPPORTS, PRISES DE POSITION
1. Plan de travail de l’EMA : Données et IA dans la réglementation des médicaments à l’horizon 2028
L’EMA et le réseau HMA (Heads of Medicines Agencies) ont publié un plan de travail conjoint intitulé « Données et IA dans la réglementation des médicaments à l’horizon 2028 ». Ce plan explique comment le réseau européen de réglementation des médicaments prévoit d’exploiter d’importants volumes de données réglementaires et sanitaires, ainsi que de nouveaux outils, dont l’IA, pour encourager la recherche, l’innovation et soutenir la prise de décision réglementaire ; ceci, afin de proposer de meilleurs médicaments plus rapidement aux patient(e)s.
Le plan de travail établit une feuille de route pour la gestion, l’analyse et le partage des données au sein du réseau, tout en respectant des normes de sécurité et d’éthique élevées. Il fournit également un cadre de coordination pour répondre aux nouvelles initiatives législatives de l’Union européenne (UE), notamment la législation pharmaceutique, l’Espace européen des données de santé (EHDS), l’Acte pour l’interopérabilité en Europe et la Loi sur l’IA.
2. Faire progresser la science réglementaire de l’EFSA : Nouveaux besoins en matière de recherche et d’innovation
Le présent éditorial fait le point sur les besoins en recherche et innovation (R&I) susceptibles de soutenir la science réglementaire de l’EFSA dans les années à venir. Le document présente les besoins de recherche pour les travaux de l’EFSA dans plusieurs domaines : technologies omiques ; microbiome intestinal ; nouvelles approches méthodologiques ; évaluation des risques d’allergénicité ; évaluation de l’exposition globale et évaluation des risques environnementaux (ERA pour environmental risk assessment).
Bien que non exhaustif et appelant à une recherche transdisciplinaire afin de couvrir les interdépendances entre la santé humaine, animale, végétale et environnementale, cet éditorial sera utile aux parties prenantes, aux responsables des programmes de recherche et aux financeurs, publics et privés, pour établir des appels à projets de recherche et de financement liés à la sécurité alimentaire.
En savoir plus (EN)
3. Opinion : Les agences du médicament pourraient-elles divulguer la liste des NAM qualifiées ?
L’Agence européenne des médicaments (EMA) a continuellement renforcé son engagement envers les 3R (remplacement, réduction et perfectionnement) et le bien-être animal grâce à un plan de travail solide et prospectif.
Cependant, dans une récente publication sur Linkedin, Thierry Decelle, de DCL Solutions, souligne un aspect manquant et précieux : la mise à disposition par les agences du médicament de la liste des NAM déjà qualifiées pour soutenir le développement de médicaments. « Il serait encore plus judicieux que l’EMA, ainsi que la FDA avec sa nouvelle feuille de route, établissent, définissent et publient des indicateurs clés de performance. Une base de référence est nécessaire pour évaluer les progrès. (…) Comme nous le savons, le nombre total d’animaux utilisés n’est pas le bon indicateur des 3R », écrit Thierry Decelle.
4. “Diversity in a dish”: les organoïdes pour refléter l’ascendance génétique et les différences entre les sexes
Les recherches actuelles mettent en évidence d’importantes disparités en matière de susceptibilité aux maladies et de réponses thérapeutiques selon les groupes ancestraux et les sexes. La sous-représentation de populations diverses dans les études génomiques freine les progrès. La plupart des études d’association pangénomique (GWAS pour Genome-Wide Association Studies) reste majoritairement européenne. De plus, les différences liées au sexe en termes de métabolisme des médicaments, de réponse immunitaire et de prévalence des maladies nécessitent des analyses stratifiées selon cette variable.
Une nouvelle revue souligne le potentiel des modèles in vitro avancés, notamment les cellules souches pluripotentes humaines (hPSC) et les organoïdes dérivés de cellules souches adultes, pour combler ces lacunes en fournissant des plateformes reflétant la diversité génétique humaine et facilitant le criblage à haut débit.
Lire la revue (EN)
INTERVIEWS, NOMINATIONS, RÉCOMPENSES
5. Comment les OOC comblent les lacunes des modèles animaux pour les essais sur les anticorps monoclonaux
Dans un article parmi sa série, CN-Bio analyse l’annonce de la FDA de supprimer progressivement l’exigence de tests sur les animaux pour les anticorps monoclonaux (AcM) et d’autres médicaments, au profit de nouvelles approches méthodologiques (NAM) adaptées à l’humain. Dans une première partie, CN-Bio revient sur les raisons qui ont motivé la décision de la FDA de se concentrer en priorité sur les AcM.
CN-Bio poursuit sa réflexion en analysant plus en détail la gamme de systèmes microphysiologiques PhysioMimix® OOC, également appelés organes-sur-puce (OOC), en explorant comment ces systèmes comblent les lacunes des modèles animaux pour le développement d’AcM et le rôle de CN-Bio pour soutenir cette transition attendue vers une approche basée sur les NAM.
6. Roper Toxicology Consulting : Lauréat des Biotechnology & Lifesciences Awards 2025
Roper Toxicology Consulting Limited, qui s’engage à aider ses clients à développer des NAM de pointe et fiables, a reçu le prix Biotechnology & Lifesciences Award 2025 de Global Health & Pharma (GHP), dans les catégories « Leader Toxicology Consultancy – UK » et « Leadership Collaboration Excellence ». Ce prix souligne l’engagement de Roper Toxicology en faveur de l’intégrité scientifique et de l’excellence réglementaire, contribuant ainsi au développement de thérapies plus sûres et plus efficaces.
Lire l’annonce par Clive Roper (EN)
En savoir plus sur les Prix GHP (EN)
DÉCOUVERTES SCIENTIFIQUES & PROTOCOLES
7. Bio-impression 3D de matrices perfusables haute résolution à base de collagène
Les systèmes d’organes-sur-puce (OoC) et les systèmes microfluidiques ont amélioré la pertinence translationnelle des systèmes in vitro. Cependant, les méthodes de fabrication actuelles limitent le choix des matériaux, les propriétés mécaniques non natives, la complexité géométrique et le remodelage cellulaire en tissus fonctionnels.
Dans un nouvel article, les auteurs ont bio-imprimé en 3D de la matrice extracellulaire et des cellules dans des matrices perfusables internes haute résolution à base de collagène qui s’intègrent à un réacteur vasculaire et de perfusion d’OoC pour former une plateforme complète d’ingénierie tissulaire. Les chercheur(e)s ont amélioré la fidélité de la bio-impression d’hydrogels en suspension afin de produire une gamme de modèles fabriqués en une seule étape. Ensemble, matrices et OoC perfusés forment une plateforme technologique permettant l’ingénierie fonctionnelle à l’échelle d’un organe complet pour la modélisation des maladies et la thérapie de remplacement cellulaire.
Lire la publication dans Sciences Advances (EN)
8. Apports d’une banque d’organoïdes dérivés de patient(e)s pour le cancer du poumon à petites cellules
Le cancer du poumon à petites cellules (CPPC) est une maladie dévastatrice dont les avancées thérapeutiques sont limitées. Bien que le CPPC ait récemment été classé en quatre sous-types moléculaires, les thérapies spécifiques à chaque sous-type font encore défaut. Dans une nouvelle étude, des chercheur(e)s ont établi 40 lignées d’organoïdes de CPPC issues de patients présentant des mutations prédominantes des gènes TP53 et RB1 et des lésions génétiques rares ciblables.
Le profilage du transcriptome a permis de distinguer les organoïdes de CPPC de type neuroendocrinien (NE) et de type non-NE, ces derniers étant caractérisés par l’expression de YAP1 ou de POU2F3. Les organoïdes de CPPC de type NE se développent indépendamment des facteurs de niche alvéolaire, tandis que les organoïdes de CPPC de type non-NE dépendent de l’activation de YAP1 et AP1 induite par le facteur de croissance analogue à l’insuline (IGF‑1). Cette librairie d’organoïdes SCLC représente une ressource précieuse pour le développement de thérapies basées sur la biologie et a le potentiel de remodeler le paysage de la découverte de médicaments.
Lire la publication dans Nature Cancer (EN)
9. Modélisation d’extrapolation in vitro vers in vivo pour faciliter l’intégration des données transcriptomiques dans l’évaluation de la génotoxicité
La transcriptomique in vitro est prometteuse pour l’obtention de données pertinentes pour l’humain, mais elle n’est pas encore intégrée aux décisions réglementaires en raison de l’absence d’approches standardisées. Pour l’évaluation de la génotoxicité, les biomarqueurs transcriptomiques tels que GENOMARK et TGx-DDI facilitent l’analyse qualitative et quantitative d’ensembles de données transcriptomiques in vitro complexes. Cependant, leur utilisation dans les tests quantitatifs nécessite des méthodes standardisées pour dériver les points de départ transcriptomiques (tPoD) et les relier aux réponses in vivo.
Dans un nouvel article, des chercheur(e)s ont étudié différentes approches de calcul des tPoD et ont appliqué l’extrapolation in vitro vers in vivo afin d’obtenir des doses équivalentes administrées (DEA). Ils ont constaté que les DEA génériques étaient plus prudents que les DEA des biomarqueurs spécifiques de la génotoxicité. Pour six des neuf génotoxiques, les DEA transcriptomiques étaient inférieurs aux DEA in vivo ; Des modèles cinétiques affinés pourraient améliorer les prédictions. Globalement, les données transcriptomiques in vitro sur les cellules HepaRG fournissent des estimations protectrices des concentrations génotoxiques in vivo, cohérentes avec d’autres systèmes de tests de génotoxicité in vitro.
Lire la publication dans Toxicology (EN)