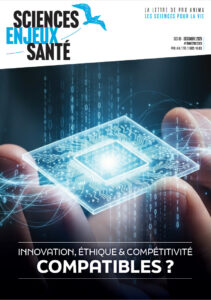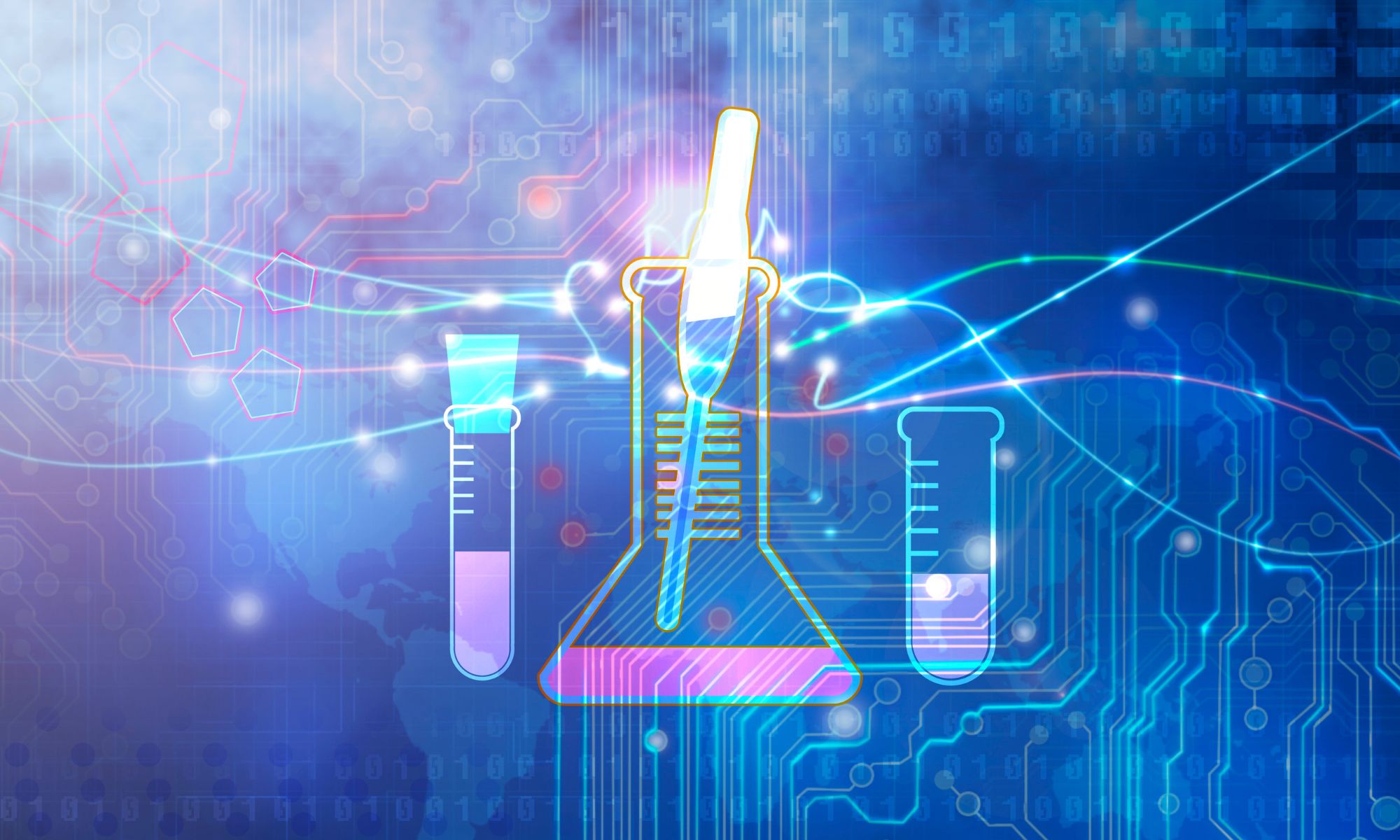
Actus des méthodes non-animales
07 - 11 JUILLET 2025
La newsletter NAM reviendra en Septembre
D’ici là, le Comité Pro Anima vous souhaite un bel été
NEWS, RAPPORTS, PRISES DE POSITION
1. DILI : Renforcer la confiance dans les MPS pour les applications réglementaires
À la croisée de l’innovation, de la collaboration et de la science se trouve un nouveau projet prometteur mené par le 3Rs Collaborative. Ce projet rassemble des organismes de réglementation, des fournisseurs de technologies, des utilisateurs et des organismes à but non lucratif afin de promouvoir une utilisation responsable des systèmes micro physiologiques (MPS) dans les applications réglementaires.
En partenariat avec le Center for Drug Evaluation and Research (CDER) de la FDA, 9 fournisseurs commerciaux, deux utilisateurs finaux, les National Institutes of Health NIH-NICEATM et le Critical Path Institute(C‑Path), se lancent dans un projet visant à évaluer l’utilisation des MPS hépatiques pour la détection des lésions hépatiques d’origine médicamenteuse (DILI). Leur objectif est d’évaluer la variabilité sur plusieurs plateformes en utilisant le même protocole expérimental, avec pour objectif ultime de renforcer la confiance dans la précision, la fiabilité et la caractérisation standardisée de ces modèles.
Lire le post LinkedIn du 3Rs Collaborative (EN)
En savoir plus sur l’initiative MPS (EN)
2. Plan stratégique 2025 – 2030 du NIH pour la science des données
Le NIH a finalisé son plan stratégique prospectif qui guidera les initiatives en science des données dans la recherche biomédicale jusqu’en 2030. Dans un nouvel article de blog, le Dr Susan Gregurick, directrice associée DATA Science au NIH, explique comment ce plan stratégique permettra : d’intégrer les technologies émergentes à la recherche biomédicale ; de construire une infrastructure de données robuste pour la découverte scientifique ; de faire progresser les normes de partage et d’interopérabilité des données ; et de former la prochaine génération de professionnels de la science des données.
Cette vision stratégique s’inscrit dans la reconnaissance croissante du rôle essentiel de la science des données comme catalyseur de l’innovation en santé et de l’amélioration des résultats pour les patients américains.
Lire l’annonce (EN)
Lire le résumé du Dr Gregurick (EN)
3. PARC : Cartographie des capacités de recherche européennes sur les risques chimiques
Plus de 70 experts de 20 pays ont contribué à une cartographie des capacités de recherche européennes, afin de poser les bases d’un environnement intégré et durable en (éco)toxicologie. L’enquête conduite d’octobre 2024 à février 2025 a recueilli des données sur les activités de recherche, les outils disponibles, les infrastructures, les formations, les questions non résolues et les besoins futurs en évaluation prospective et rétrospective des dangers.
Plusieurs défis majeurs ont été identifiés, notamment la nécessité de mieux comprendre les effets des mélanges chimiques et les mécanismes de toxicité, de développer des méthodes d’expérimentation non animales. Pour accélérer la qualité de la recherche et optimiser l’utilisation des données, les participants ont souligné les principales priorités futures : le développement de méthodes d’essai avancées, d’outils prédictifs in vitro et in silico, de méthodologies harmonisées, l’intégration de l’IA, les infrastructures scientifiques ouvertes et le renforcement de la collaboration transfrontalière.
En savoir plus (EN)
4. Approche pragmatique pour évaluer pour l’humain les voies toxicologiques et les NAM associées
Actuellement, les évaluations de la sécurité des substances chimiques reposent principalement sur des données animales. De multiples considérations justifient le recours à des stratégies d’essai alternatives basées sur des méthodologies de nouvelles approches (NAM). Cependant, la pertinence de ces stratégies d’essai pour l’humain est généralement incertaine. Il est donc nécessaire d’établir un processus harmonisé et reconnu pour évaluer leur applicabilité à des fins réglementaires.
Ce rapport propose une approche applicable à l’évaluation pour l’humain d’une voie toxicologique et de la pertinence des NAM liées à ses différentes composantes. Le processus d’évaluation part d’une voie toxicologique établie, dont l’effet indésirable est pertinent pour l’évaluation des risques pour la santé humaine et dont le poids des preuves est suffisant. La pertinence pour l’humain est évaluée à travers trois questions principales : les différentes composantes (étapes) de la voie, la pathologie des syndromes humains ayant un effet indésirable similaire et les aspects quantitatifs.
Lire le rapport (EN)
5. L’IA peut-elle créer une cellule virtuelle ? Les scientifiques se démènent pour modéliser la plus petite unité du vivant
Les biologistes utilisent des ordinateurs pour modéliser le comportement cellulaire depuis des décennies. Les efforts pour créer des cellules virtuelles en sont à leurs balbutiements, mais l’idée suscite un vif intérêt dans les laboratoires universitaires et industriels du monde entier. « C’est une tâche gigantesque », déclare Jan Ellenberg, biologiste moléculaire au Science for Life Laboratory, un institut national de recherche basé à Solna, en Suède. « Ce qui est possible et nécessaire aujourd’hui, c’est de mettre en place les premiers projets pionniers démontrant que cela peut, en principe, fonctionner. »
L’effort actuel pour développer des cellules virtuelles tire parti des avancées de l’IA, qui permettent la création de représentations sophistiquées de données, comme le texte, dans le cas des grands modèles linguistiques, lorsqu’ils sont entraînés sur de grandes quantités de données. « Construire des modèles qui apprennent à partir de données est révolutionnaire », déclare Stephen Quake, directeur scientifique de la Chan Zuckerberg Initiative (CZI) à Redwood City, en Californie, et l’un des chercheurs à la tête de la création de cellules virtuelles.
En savoir plus dans la revue Nature (EN)
OUTILS, PLATEFORMES, APPELS
6. PEPPER 2025 : Appel ouvert pour des méthodes d’essai sur la perturbation endocrinienne
Chaque année, Pepper sélectionne des méthodes d’essai sur la perturbation endocrinienne présentant un haut niveau de maturité technologique, développées par des laboratoires publics ou privés, pour en soutenir la validation. Cette initiative vise à combler le déficit de méthodes validées.
Les méthodes proposées doivent répondre aux critères suivants : un haut degré de maturité (protocole écrit solide, données suffisantes – voir ReadEDtest) ; répondre aux attentes des instances réglementaires (par exemple, des modes d’action pour lesquels aucun test n’est actuellement disponible) ; possibilité d’intégration dans une stratégie d’évaluation ; bon potentiel de diffusion dans les laboratoires ; absence d’obstacles logistiques ou juridiques.
Ne sont pas éligibles : les méthodes in silico, les approches hors cadre 3R, les méthodes déjà en cours de validation, ou qui reproduisent des méthodes déjà validées.
Date limite de soumission : 31 août 2025
En savoir plus et candidater (EN)
7. TSAR et BimmoH : le système européen de suivi des méthodes alternatives en vue de leur acceptation réglementaire
Au cœur de l’infrastructure de l’EURL ECVAM se trouve TSAR, le Tracking System for Alternative Methods towards Regulatory Acceptance. Développé il y a plus de dix ans, TSAR suit le parcours des méthodes alternatives soumises à des essais de sécurité, à chaque étape : soumission, validation, évaluation par les pairs, normalisation internationale, puis adoption réglementaire finale.
Prévu pour être lancé courant 2025, le BioMedical Model Hub (BimmoH) est la toute dernière initiative de l’EURL ECVAM visant à recenser l’explosion des modèles non animaux issus de la recherche biomédicale. Alimenté par l’IA et s’appuyant sur les données de PubMed, BimmoH est conçu pour extraire, filtrer et classer les publications scientifiques utilisant des modèles fondés sur la biologie humaine, permettant ainsi des approches sans recours aux animaux. « Dans certains domaines, nous sommes très proches de l’abandon progressif des animaux », déclare le Dr Ingrid Langezaal, toxicologue et responsable scientifique à l’EURL ECVAM. « Dans d’autres, le chemin reste long. Mais les données nous permettent d’avancer. »
En savoir plus (EN)
8. Young TPI Conference 2025 : Connecting the Dots
Les 23 et 24 octobre 2025, au Trippenhuis d’Amsterdam, rejoignez la communauté TPI pour une conférence de deux jours réunissant de jeunes professionnel(le)s, chercheur(e)s, enseignant(e)s et décideurs politiques engagés dans la transition vers des approches sans recours aux animaux. À travers des conférences plénières, des ateliers pratiques, des sessions de posters et des temps de networking, l’événement vise à connecter des disciplines variées et à encourager la collaboration dans les domaines suivants : Modèles technologiques et de recherche ; Sciences de la transition ; Éducation ; Politique et Législation.
Soumettre un abstract pour présenter vos travaux avant la date limite : 15 août, 17h00 CEST
S’inscrire pour assister à la conférence avant la date limite : 30 septembre, 17h00 CEST
En savoir plus sur LinkedIn (EN)
En savoir plus sur le site du Young TPI (EN)
DÉCOUVERTES SCIENTIFIQUES & PROTOCOLES
9. OrganoidChip+ : une plateforme microfluidique pour la culture, la coloration, l’immobilisation et l’imagerie à haut contenu d’AOP
L’imagerie à haut contenu (HCI) et son analyse sont essentielles pour approfondir notre compréhension des mécanismes de l’organogenèse. Pour cela, il est crucial de cultiver des organoïdes dérivés de cellules souches adultes (ASOs pour adult stem cell-derived organoids) sur une plateforme qui permet également l’imagerie en temps réel, la coloration, l’immobilisation ainsi qu’une imagerie rapide à haute résolution. Or, les plateformes actuelles ne répondent que partiellement à ces exigences.
Dans une nouvelle étude, des chercheur(e)s présentent OrganoidChip+, un dispositif microfluidique tout-en-un conçu pour intégrer à la fois la culture et l’HCI des ASO sur une même plateforme. OrganoidChip+ offre plusieurs fonctionnalités supplémentaires par rapport à la version précédente de l’OrganoidChip, notamment la possibilité de réaliser la coloration par fluorescence et l’imagerie sans avoir à transférer les échantillons.
En savoir plus sur bioRxiv (EN)
10. Justification des groupes chimiques pour le read-cross à l’aide de profils de réponse moléculaire
En regroupant des substances chimiques présentant des similarités structurelles, il est possible d’appliquer les résultats d’évaluation de la toxicité de substances bien documentées à d’autres, moins étudiées. Cette approche soutient l’évaluation des risques environnementaux et sanitaires sans recourir à l’expérimentation animale. Toutefois, la similarité structurelle à elle seule ne suffit pas : des données supplémentaires sont nécessaires pour renforcer la justification scientifique du regroupement.
Dans une nouvelle étude, des chercheur(e)s ont démontré comment des données de bioactivité multi-omiques peuvent améliorer la confiance dans une hypothèse de regroupement, les profils de bioactivité pouvant refléter les modes d’action d’une substance chimique. Ils ont analysé trois phtalates structurellement similaires et trois découpleurs de la phosphorylation oxydative, en combinant des approches de regroupement fondées sur la structure avec des expositions à court terme de l’espèce écotoxicologique Daphnia magna, afin de générer des données multi-omiques.
Lire la publication dans Regulatory Toxicology and Pharmacology (EN)