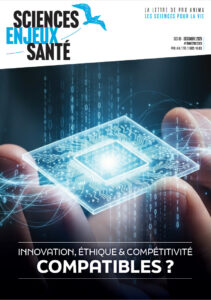Prix Descroix-Vernier EthicScience 2025
Les principaux acteurs
SES116 – Mars 2025
Christiane Laupie-Koechlin, fondatrice du Comité scientifique Pro Anima et du Prix,
entourée du Dr Jean-Pierre Cravedi, Jean-Baptiste Descroix-Vernier
& du Sénateur Arnaud Bazin

Christiane Laupie-Koechlin & Dr Lilas Courtot, responsable scientifique du Comité Pro Anima
SÉNATEUR ARNAUD BAZIN : PARRAIN DU PRIX DVES

Comité Pro Anima : Le Prix DVES est l’un des seuls prix français entièrement dédié aux travaux scientifiques hors modèle animal, mettant en avant des nouvelles méthodes et technologies dont certaines comme les organes-sur-puce et l’IA démontrent un réel potentiel pour la recherche biomédicale et les tests toxicologiques. Vous aviez d’ailleurs adressé en mai 2024 une question écrite à Madame la Ministre de la Santé sur l’utilisation du “foie-sur-puce” en stade préclinique. Quels sont pour vous les avantages et les promesses de ces nouvelles méthodes et technologies ?
Sénateur Arnaud Bazin : Les nouvelles méthodes comme les organes-sur-puce et les méthodes in silico, ouvrent des perspectives majeures en recherche biomédicale et en toxicologie. Les organes-sur-puce permettent des tests plus précis, plus prédictifs tout en supprimant le recours aux animaux. Le « foie-sur-puce », par exemple, permet d’évaluer la toxicité hépatique médicamenteuse de façon plus fiable qu’un modèle animal.
Ces nouvelles méthodes s’intègrent également dans la médecine personnalisée et permettent d’adapter les traitements aux caractéristiques génétiques et physiologiques de chaque patient.
Non seulement la recherche et le soin deviennent plus efficaces, plus représentatifs de l’humain, plus rapides et efficients mais ces technologies permettent d’épargner beaucoup de souffrances et de vies animales.
P.A : L’implémentation des méthodes non animales est assujettie à une volonté politique, scientifique et réglementaire et requiert un financement à la hauteur des enjeux de santé, de compétitivité et d’innovation du 21e siècle. Quels leviers apparaissent pour vous essentiels, et quelles sont les opportunités à ne pas manquer pour la recherche en France dans les années à venir ?
Sénateur A. Bazin : Il est urgent de supprimer l’obligation réglementaire d’effectuer les tests précliniques sur des animaux (dont l’origine remonte au code de Nuremberg, il y a près de 80 ans), à l’instar de ce qu’ont fait les Etats-Unis en 2022. En imposant une méthode de test obsolète aux développeurs de médicaments, on encourage l’administration de médicaments potentiellement nocifs à des sujets humains (rappelons que 90% des médicaments ne passent pas les premiers essais sur des sujets humains).
Tant que cette obligation persistera, le développement des ces techniques sera freiné.
En parallèle, ces nouvelles méthodes doivent être intégrées aux procédures réglementaires de développement de médicaments.
L’UE devrait porter ces évolutions réglementaires mais, à défaut, la France, qui occupe une position mondiale notable en recherche scientifique, a le devoir de les initier.
DR JEAN-PIERRE CRAVEDI : PRÉSIDENT DU COMITÉ DE SÉLECTION DU PRIX

Comité Pro Anima : L’évaluation des risques liés à l’exposition aux substances chimiques est un défi majeur pour les toxicologues qui sont confrontés au nombre croissant de substances produites par l’homme, aux effets cocktails, ou encore aux risques émergents tels que les nanoparticules et les nano-plastiques par exemple. Quel est pour vous l’intérêt et le potentiel de ces nouvelles méthodes et technologies notamment pour la toxicologie d’aujourd’hui et de demain ?
Dr. Jean-Pierre Cravedi : Les estimations les plus récentes parlent de 350 000 substances chimiques présentes sur le marché mondial et si l’on se réfère à l’ECHA (l’Agence européenne des produits chimiques) plus de 1700 substances chimiques produites ou importées en Europe à plus d’une tonne/an sont enregistrées annuellement. Il faut préciser que ces 1700 substances ne comprennent pas les médicaments, les additifs alimentaires, les arômes, ou encore les pesticides, pris en charge par ailleurs. À la difficulté de disposer de données toxicologiques suffisantes pour l’ensemble de ces substances, il faut ajouter celle qui relève de la toxicologie des mélanges parfois très complexes, ou encore des innombrables produits de dégradation qui peuvent se former et persister dans notre environnement.
Ce constat fait naître une évidence : il est illusoire de vouloir continuer à baser l’évaluation des risques chimiques sur des expérimentations animales longues et coûteuses. Si l’on prend l’exemple des études toxicologiques actuellement requises dans le cadre d’un dépôt d’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique, il faut compter plus de 10 ans de travaux expérimentaux, le sacrifice d’environ 10 000 animaux, pour un coût de plus de 3 millions d’euros. La situation est sensiblement la même pour les médicaments. Il y a donc une incompatibilité entre les approches mises en œuvre au cours des 50 dernières années en matière de toxicologie, pharmacologie ou recherche médicale et les défis auxquels nous sommes confrontés. Si l’on ajoute à cela les incertitudes liées aux extrapolations animal-humain, il ne fait aucun doute que nous devons changer de paradigme et nous appuyer bien davantage sur les données produites in silico et in vitro, en grande partie sur des modèles humains. Dans ce domaine, les progrès sont rapides et les initiatives de plusieurs agences d’évaluation du risque d’intégrer ces approches dans la caractérisation du danger de plusieurs catégories de substances pour les populations exposées sont encourageantes.
“Il est illusoire de vouloir continuer à baser l’évaluation des risques chimiques sur des expérimentations animales longues et coûteuses.”
P.A : En tant que président du comité stratégique du Prix DVES, vous avez sélectionné avec les membres du comité les lauréats de cette édition 2025, récompensant des techniques et domaines de premier plan : cancérologie, neurologie et obésité. Quels sont selon vous les domaines d’orientation / clés de la recherche vers lesquels tourner notre regard et que le Prix pourrait plus spécifiquement encourager à l’avenir ?
Dr. Cravedi : Les champs de recherche actuels en matière d’alternatives à l’expérimentation animale sont vastes. En 2025, les candidatures récompensées ont tiré parti d’approches innovantes comme la microfluidique et les puces qui y sont associées, technologie qui permet par exemple d’appréhender le micro-environnement tumoral et d’espérer rendre plus efficace les traitements anti-cancéreux ou encore de disposer de capteurs neuronaux capables d’identifier les substances susceptibles d’interagir avec les cellules nerveuses et de ce fait envisager des progrès significatifs dans le traitement de la douleur ou le diagnostic des maladies neurodégénératives.
Autre champ d’investigation en plein essor dans le domaine de la biologie, la toxicologie et la recherche médicale : celui des organoïdes, qui sont des organes miniatures, généralement fabriqués à partir de cellules souches. Ils constituent un modèle intermédiaire entre les cultures cellulaires et l’organisme entier et s’appliquent à une grande variété d’études : criblage de médicaments ou de substances chimiques, modélisation de pathologies, identification des mécanismes d’action, etc. Plusieurs organes font l’objet de ces méthodologies : foie, rein, poumon, intestin, cerveau, etc. Cette année, nous avons souhaité donner un coup de projecteur à des travaux portant sur des organoïdes d’origine humaine mimant le tissu adipeux obèse afin de mieux comprendre le fonctionnement physiopathologique de ce tissu et à terme améliorer l’efficacité des traitements à disposition des professionnels de santé.
La toxicologie computationnelle, qui s’appuie sur des données provenant de diverses sources et des modèles mathématiques capables de les intégrer, permet de mieux appréhender les effets sur la santé que peuvent entraîner les toxines, les médicaments et plus largement les produits chimiques. Les premiers développements de ce secteur de recherche ont porté, entre autres, sur les QSAR (relations quantitatives structure-activité) et ont permis des avancées significatives dans le design des médicaments et dans la prédiction des effets toxiques des substances chimiques.
D’autres initiatives, basées sur des modèles mathématiques, visent à prédire le devenir des substances chimiques naturelles ou synthétiques dans l’organisme. Parmi ces dernières, les modèles pharmacocinétiques physiologiques (PBPK) qui renseignent sur l’absorption, la distribution, le métabolisme et l’excrétion des molécules pénétrant dans l’organisme par voie orale, cutanée ou pulmonaire. Dans le même registre, figure l’élaboration de modèles mathématiques permettant d’extrapoler les données pharmacocinétiques ou pharmacodynamiques obtenues in vitro à l’échelle de l’organe entier ou de l’organisme entier (modèle IVIVE).
Aujourd’hui, ces approches qui se diversifient et tirent parti des progrès de l’IA (intelligence artificielle), constituent sans aucun doute, une voie prometteuse de recherche et de réduction du recours aux expériences chez l’animal. Elles sont complémentaires des développements d’outils biologiques et méritent d’être encouragées, au même titre que le recours aux organoïdes ou la microfluidique.
JEAN-BAPTISTE DESCROIX VERNIER : PHILANTHROPE & DIRIGEANT D’ENTREPRISE

 Comité Pro Anima : Comité Pro Anima : S’il fallait, parmi toutes les actions bénéfiques de votre Fondation, en retenir une, laquelle mentionneriez-vous ?
Comité Pro Anima : Comité Pro Anima : S’il fallait, parmi toutes les actions bénéfiques de votre Fondation, en retenir une, laquelle mentionneriez-vous ?
Jean-Baptiste Descroix-Vernier : Je ne sais pas. Comment choisir entre un SDF de 75 ans à qui on a donné un logement décent, une petite fille de 10 ans qu’on a sortie de la misère ou un bébé sauvé de la dysenterie ? Je m’endors chaque soir avec des milliers de visages qui me sourient et je me réveille chaque matin avec ceux qui pleurent. Je ne sais pas si je dois être fier de tout ce qu’on a fait ou terrifié par tout ce qu’il reste à faire.
P.A : Le Prix DVES est l’un des seuls prix français entièrement dédié aux travaux scientifiques hors modèle animal, et compte parmi les prix européens les mieux dotés en la matière. Quel est pour vous l’intérêt essentiel à soutenir ces nouvelles méthodes et technologies ?
JBDV : À notre époque, des technologies de pointe existent pour imprimer des tissus humains, cultiver des tumeurs sur-puces pour tester des traitements, etc. Il faut les mettre en avant non seulement pour le bien-être de l’humanité, mais aussi pour sa sauvegarde morale. On ne peut pas prétendre sauver des vies en en détruisant d’autres alors que c’est évitable.
“On ne peut pas prétendre sauver des vies en en détruisant d’autres alors que c’est évitable”
P.A : La recherche non animale convoque des enjeux de santé publique et globale (humains, animaux, environnements) sans précédent. Comment imaginez-vous l’évolution du Prix pour sa prochaine édition en 2027 et sa contribution face à ces enjeux ?
JBDV : Le prix DVES est à l’avant-garde de ce mouvement. Il récompense, met en valeur et honore ce qu’il y a de plus beau dans la recherche moderne. Il pourrait primer de nouvelles sciences, si elles sont mises au service de l’humanité. L’intelligence artificielle, par exemple, en fait partie. La science, les sciences, entrent dans une nouvelle ère où biologie et hautes technologies ne feront plus qu’une, comme l’astrophysique a rejoint la physique quantique. Rien de fort ne se fait sans penser aux plus faibles.

Crédit image : Comité scientifique Pro Anima, Axel Coquemon